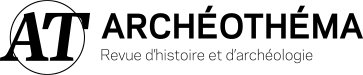Sommaire
Le dossier
- Introduction, par Philippe Depreux
- Who’s who, glossaire, chronologie
- Une dynastie élue de Dieu, par Stuart Airlie, Philippe Depreux, Sylvie Joye, Charles Mériaux et Helmut Reimitz
- Le contexte économique, par Étienne Renard
- Autorité, pouvoir et contrôle social, par Jean-François Boyer, Philippe Depreux, Stefan Esders, Sylvie Joye, Rob Meens, Charles Mériaux, Steffen Patzold et Bernhard Zeller
- Les missi et l’inquisitio, par Stefan Esders
- La pénitence, un instrument de réconciliation et de contrôle politique, par Rob Meens
- La transmission des noms par variation dans une famille de colons du domaine de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés à Palaiseau vers 820, par Sylvie Joye
- L’instrumentalisation de la prière, par Philippe Depreux et Michèle Gaillard
- Le plan de Saint-Gall, par Michèle Gaillard
- La confraternité d’Attigny, par Michèle Gaillard
- Pastorale et culture, par Charlotte Denoël, Jens Schneider, Sumi Shimahara et Michel Sot
- Un scriptorium: Tours, par Charlotte Denoël
- Intégration et unité, par Florence Close, Sören Kaschke, et Jens Schneider
- Le legs carolingien, par Julien Bellarbre et Philippe Depreux
Les actualités
- Qumrân, le secret des manuscrits de la mer Morte, exposition à la BnF, par Bruno Bioul
- Bordeaux, lot d’amphores de Lipari, par Jérôme Hénique et Laetitia Pédoussaut
- Découvertes et chantiers en cours
- Livres du mois
6,00 €
AT08 – Le renouveau Carolingien, 730-830
Un auteur a beaucoup fait pour jeter le discrédit sur la dynastie mérovingienne: Éginhard, à qui l’on doit le cliché du roi mérovingien de la première moitié du VIIIe siècle, qui «n’avait plus, en dehors de son titre, que la satisfaction de siéger sur son trône, avec sa longue chevelure et sa barbe pendante» et qui se déplaçait «dans un chariot attelé de bœufs et conduit par un bouvier, à la mode rustique». La civilisation mérovingienne n’a rien à envier à celle à laquelle elle a donné naissance et elle a connu des rois pleins de dynamisme, tels Clovis Ier ou Dagobert Ier, et soucieux d’améliorer le gouvernement du royaume en légiférant, tel Clotaire II. Mais il est vrai que le poids croissant des aristocraties régionales dans un vaste «royaume des Francs» qui n’était unitaire que de nom éclipsa la dynastie régnante et permit l’essor d’une autre famille, celle des Pippinides, au point qu’à partir des années 730,«l’administration et toutes les décisions et mesures à prendre, tant à l’intérieur qu’au dehors, étaient du ressort exclusif du maire du palais». Ce second extrait de la Vie de Charlemagne est, quant à lui, exact. Il explique l’évincement de Childéric III (743-751) avec la bénédiction de la papauté, et l’installation sur le trône de la famille qui, effectivement, exerçait le pouvoir.
Mais gouverner un vaste royaume, dont les frontières furent sans cesse repoussées jusqu’au début du IXe siècle, n’était pas chose évidente, et les Carolingiens durent, eux aussi, lutter – finalement en vain – contre l’ascension politique de familles qui les avaient servis et contre les forces centrifuges d’une aristocratie qui, bien que possessionnée dans tout l’Empire et interconnectée par divers mariages, jouissait d’une assise essentiellement régionale. Cette histoire, dans le contexte troublé des raids toujours plus fréquents des «hommes du Nord» (les Danois, Vikings et autres Normands), pourrait aussi faire l’objet d’une mise au point, car l’image des pillages de Barbares saccageant les trésors des églises est tout aussi caricaturale que celle des rois fainéants. Certes, les Nortmanni furent considérés par leurs contemporains comme le «fléau de la vengeance divine», alors que l’appât de l’or et la nécessité sociale de se faire un nom par le butin étaient des mobiles puissants au sein des sociétés nordiques, mais les Carolingiens avaient, en quelque sorte, introduit le loup dans la bergerie (dans le conflit qui opposera les fils de Louis le Pieux à la mort de leur père, ils succomberont d’ailleurs occasionnellement à la tentation de «pactiser avec le diable» pour mieux se nuire mutuellement). Des contacts avaient été noués par l’intermédiaire de marchands, notamment les Frisons, et des places commerciales comme celle de Haithabu, tout près du Danewerk, cette limite méridionale du monde danois, jouèrent un rôle essentiel dans l’attraction qu’exerça le monde franc sur les Scandinaves, que Louis le Pieux ambitionnait de convertir après la conquête de la Saxe par son père. L’anecdote relatée vers la fin du IXe siècle par un moine de Saint-Gall, Notker le Bègue, ne reflète-t-elle pas le malentendu qui présidait aux relations avec les Dani? Lors d’une arrivée massive de ces païens à la cour, on avait dû confectionner des vêtements blancs dans l’urgence et l’un d’eux, au sortir du baptême, s’était plaint d’avoir reçu un linge d’une bien moins bonne qualité que dans les années précédentes!
Le modèle de société que Charlemagne et Louis le Pieux voulaient imposer dans leur royaume et exporter, d’abord par la force, puis par la persuasion, fut celui d’une société chrétienne où tous les efforts étaient tendus vers l’amélioration de la formation (formation de base du clergé et des fidèles, maîtrise des arts libéraux et de la théologie pour les élites) et le contrôle des mœurs, pour mener le peuple au salut. C’est ce qu’affirme Charlemagne dans le premier grand capitulaire programmatique promulgué par un souverain franc, l’Admonitio generalis (789), par lequel il s’efforce de «corriger les erreurs, supprimer ce qui est superflu et encourager ce qui est juste» car «il est nécessaire de rassembler tous ceux que nous pouvons en vue de la pratique d’une bonne vie en l’honneur et à la gloire de notre Seigneur, Jésus-Christ». Son successeur n’eut pas d’autre ambition. Or la possibilité même de formuler un tel programme était le résultat d’une génération de remise en ordre du clergé, promue par Carloman et Pépin le Bref, les fils de Charles Martel, ce maire du palais désormais unique sur lequel la papauté, en la personne de Grégoire III (731-741), avait misé: le présent volume est, précisément, consacré à l’histoire de ce que, s’il ne nous avait pas légué la plupart des manuscrits par lesquels nous connaissons la littérature antique latine et s’il n’avait pas durablement marqué notre histoire politique, institutionnelle et sociale, l’on pourrait presque appeler une utopie – le renouveau carolingien, appréhendé dans sa période d’essor et à son apogée.