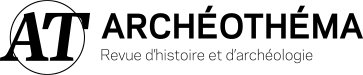Sommaire
Le dossier
- Cluny entre héritages et innovations, par Arlette Maquet
- Chronologie
- Le cadre historique et le premier âge féodal, par Olivier Bruand
- L’abbaye de Gigny, par Christian Sapin
- L’abbaye de Baume, par Sébastien Bully, Marie-Laure Bassi et Laurent Fiocchi
- 80 ans d’archéologie à Cluny, par Anne Baud et Christian Sapin
- Au fil de la Grosne: Cluny et la rivière, par Gilles Rollier
- Saint-Pierre de Souvigny, par Pascale Chevalier et Laurent Fiocchi
- Grès et carrières du Bourbonnais, par Sophie Liegard et Alain Fourvel
- Paray-le-Monial, de l’abbé Mayeul à Hugues de Semur, par Gilles Rollier
- Romainmôtier, par Jean-Daniel Morerod
- Les moines et l’art, par Bruno Phalip
- De la célébration des abbés à la souveraineté de Cluny, par Elena Magnani
- Écrire le chant à Cluny, par Eduardo Henrik Aubert
Les actualités
- Méroé, un empire sur le Nil exposition au Musée du Louvre, entretien avec Guillemette Andreu-Lanoë, directrice du département des antiquités égyptiennes du Louvre
- Les origines gauloises de Toulouse
- Découvertes, chantiers en cours et livres
6,00 €
AT07 – Cluny, aux origines de la communauté
Le onzième centenaire de la fondation de Cluny célébré en 2010 a été l’occasion d’évoquer les premiers temps de cette communauté dont la gloire a souvent occulté les débuts. Pour Cluny, le Xe siècle est autant celui de la construction institutionnelle qu’architecturale. Ces dernières années ont été celles d’un renouvellement de l’analyse historique tout autant que des progrès archéologiques qui, de Baume à Souvigny en passant par Cluny, modifient nos perceptions sur les origines de ces communautés.
Cluny ne s’installe pas dans un désert religieux car de nombreux établissements monastiques ou canoniaux existent à travers le territoire. La fondation de Cluny n’a en soi rien d’original: c’est celle d’un grand aristocrate carolingien, Guillaume, duc d’Aquitaine, comte de Macon et d’Auvergne, qui crée en 909 ou 910 un monastère dans une de ses propriétés, un geste maintes fois répété. En cela et par la personnalité de son fondateur, cette communauté s’inscrit dans un héritage carolingien. À la tête de sa fondation, Guillaume installe Bernon, abbé de Gigny et Baume qui portent en elles la tradition monastique du Jura. C’est donc dans une succession multiple et complexe que s’inscrit Cluny. Ainsi un multi-abbatiat se met en place, et Bernon puis Odon sont, à titre personnel, abbés de nombreuses communautés (Déols, Massay) alors que dans chaque établissement un autre abbé assure la gestion du quotidien. L’expansion se développe d’abord dans les territoires guilhemides (voir glossaire) ou apparentés comme la Provence et l’Auvergne. L’immunité et l’exemption confèrent à Cluny des possibilités d’actions en la libérant d’une tutelle épiscopale ou seigneuriale directe. À ces biens qui vont constituer la terre de saint Pierre s’ajoutent des maisons confiées pour réforme sans pour autant intégrer la communauté. C’est cependant ainsi que «l’esprit» de Cluny se diffuse via un «ordo». Pour autant, il n’y a pas à cette date d’unification entre les différentes maisons, encore moins d’ordre.
Ce qui va faire aussi le succès de Cluny, c’est sa capacité à s’intégrer au monde laïc et à en satisfaire les besoins: gestion de la mémoire des morts, intégration des donateurs dans la communauté, prières. Grâce à ce système don/contre-don, Cluny va alors devenir une seigneurie ecclésiastique, et si le moine est pauvre, la communauté s’enrichit. Les longs abbatiats successifs de Mayeul (954-994), Odilon (994-1049) et Hugues (1049-1109) contribuent à en installer la puissance dans le contexte d’une société en gestation.
Ce monastère est devenu progressivement un modèle envié, imité puis critiqué, à la tête d’un ensemble de maisons, l’ecclesia cluniacensis, puis d’un ordre (à partir du XIIIe siècle) qui compte plusieurs centaines d’établissements dispersés à travers la majeure partie de l’Europe. Cette puissance est le résultat de la conjonction de circonstances favorables et de l’influence personnelle des individus présents à la tête de la communauté pendant de longues années. Cette puissance s’inscrit dans l’espace par les réalisations architecturales (Paray, Romainmôtier, Souvigny), mais le meilleur symbole en demeure la Major Ecclesia.