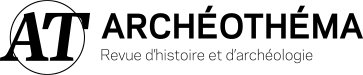Sommaire
Le dossier
- Liminaires. Le développement du judaïsme et de la religion judéenne, par Arnaud Sérandour
- «Je suis Gabriel, son Ange», par David Hamidovic
- La Bible des Septante, par Gilles Dorival
- L’édit de Séleucos IV qui bouleversa Jérusalem, par Estelle Villleneuve
- Sadducéens, esséniens et pharisiens, par Simon C. Mimouni
- Les courants nazoréen, prophétiques, messianiques et baptistes, par Simon C. Mimouni
- Le groupe des thérapeutes, par Simon C. Mimouni
- Les Samaritains à l’époque hellénistique, par Arnaud Sérandour
- Hérode le Grand et les conséquences de sa politique, par Christophe Mézange
- Les sicaires ne sont pas des zélotes, par Christophe Mézange
- Synagogue et targum, par Thierry Legrand
- L’hébreu, l’araméen et le grec, par Thierry Legrand
- L’inclassable Rouleau de cuivre…, par Thierry Legrand
Les actualités
- Plagne. Les plus grandes empreintes de dinosaures au monde, entretien avec Pierre Hantzpergue, professeur de géologie à l’université Claude Bernard Lyon I (UMR CNRS 5125)
- Catalogne. Le festival médiéval «Terre de troubadours» à Castelló d’Empúries, par Bruno Bioul
- Découvertes et chantiers en cours, sortie culturelle, expositions et livre
6,00 €
AT05 – Les Judaïsmes au temps de Jésus
À l’origine, qui remonte à l’époque perse, le judaïsme désigne un système d’organisation tout à la fois politique et religieux qui s’est développé dans le contexte d’une minuscule province d’empire, dans des circonstances particulières nées de conditions historiques locales particulières. Contrairement à une opinion répandue, ce que l’on appelle d’ordinaire le «monothéisme» juif – terme moderne qui ne rend que très imparfaitement compte des réalités du judaïsme antique – n’est pas né d’un développement interne continu et comme naturel, téléologique, propre à la religion juive. Il s’agit en fait d’une consécration exclusive de tous et de chacun des gens de Judée au seul dieu national, qui est un dieu parmi tous les autres, autochtones et allogènes.
Constituant un groupe humain d’origine diverse en un peuple lié par serment à un souverain divin, cette religion particulière est née de circonstances avant tout politiques et sociales dans une situation locale déterminée. Tel qu’il s’est institué progressivement sous la domination perse et jusqu’au début de l’époque hellénistique, le judaïsme constitue une réponse locale et ponctuelle à la question concrète d’assujettir une population d’abord clairsemée aux règles coutumières locales, dans une province placée sous l’administration directe d’un pouvoir étranger, incompétent en la matière et peu désireux d’y rétablir la royauté. Selon la représentation du monde prévalant au Proche-Orient ancien, le roi humain détient son pouvoir des dieux qui l’ont choisi pour administrer le pays en leur nom. L’ancien dieu du trône assume désormais la souveraineté éminente, représenté ici-bas par une aristocratie sacerdotale qui s’est unifiée et hiérarchisée sous la houlette d’un grand prêtre héréditaire qui, depuis le temple de Jérusalem, étend sa juridiction sur l’ensemble des institutions religieuses des Judéens où qu’ils résident. Le grand prêtre apparaît ainsi comme le médiateur institutionnel par excellence entre le peuple et le dieu national, en lieu et place du roi. L’idéal politique du judaïsme s’exprime dans l’idéologie de l’Alliance sacerdotale, annoncée comme Nouvelle Alliance par les livres prophétiques de Jérémie (23,5; 31,33; 33,17-18 sqq.) et de Zacharie (Za 4; 6,12-13). Comme le montrent en particulier ces deux prophètes, l’Alliance sacerdotale ne supplante pas l’Alliance royale, mais garantit les promesses divines à David, réservant ainsi au pouvoir royal ses prérogatives et ses apanages. La séparation des pouvoirs politique et religieux se présente en effet comme le principe fondateur de l’Alliance sacerdotale, dans la ligne politique du pouvoir perse. Or, durant toute l’époque perse, la fonction royale avait été confiée par l’Empire à un gouverneur. Rien n’empêchait de penser que la royauté pourrait être rétablie dans le pays, dans un avenir imprévisible à vues humaines.
À l’époque hellénistique, la fonction de gouverneur n’est plus attestée dans la documentation. À titre d’«ethnarque», «chef de la nation», le grand prêtre fait désormais figure de chef spirituel et temporel de toute la nation des Judéens qui ressortit à son autorité, qu’ils résident dans la province ou en diaspora. En tant que communauté tributaire reconnue, les Judéens possèdent le privilège, par la grâce du souverain, de s’organiser en fonction de leurs coutumes ancestrales, dont le grand prêtre est le garant et le dépositaire suprême. Cette fonction de dépositaire du coutumier de la province, placé sous l’autorité éminente du dieu national transmis par Moïse, le grand prêtre la partage avec toute l’aristocratie sacerdotale, qui contrôle l’administration et le système judiciaire de la province, et avec les anciens de la nation, institution également aristocratique, ramifiée jusque dans les villes et les villages de la province.
Chargée de l’administration et des tribunaux des chefs-lieux locaux, l’institution traditionnelle des anciens évolue vers un conseil des anciens de la nation ou Sénat, appelé gérousia puis Sanhédrin («Assemblée»), aux compétences administratives et religieuses qui embrassent tous les domaines de la vie quotidienne. Le grand prêtre est aussi l’agent local du roi macédonien devant lequel il est responsable.Les relations du grand prêtre avec le roi sont étroites, parfois orageuses et, à partir du règne d’Antiochus IV, les grands prêtres sont directement nommés par le roi séleucide, sans toujours tenir compte du caractère théoriquement viager de la fonction. Le roi tient donc désormais le grand prêtre dans sa main jusqu’à la création de l’État juif.
Le Temple est devenu l’âme de la vie publique, sociale et économique. Il est devenu le centre de l’identité des Judéens parce que la Loi sort du Temple (Mi 4,2). La participation au culte vaut à tout le peuple un droit patrimonial dans le territoire relevant de la souveraineté du dieu national. Ce titre de propriété est garanti à tous par le lien généalogique symbolique qui unit tous les «fils d’Israël» de toutes époques à ceux qui ont rebâti le temple et les murs de la ville sainte (Esd 2 // Ne 7) et, au-delà, aux ancêtres qui ont fait alliance au Sinaï avec le dieu national en jurant d’obéir aux lois divines transmises par Moïse (Ex 19-24).
La société reflète l’organisation du culte. Hiérarchisé en «prêtres», «lévites» et «fils d’Israël», le «peuple de Yahweh» forme une cour organisée en cercles concentriques autour de l’autel et du Temple. Ces cercles sont hiérarchisés du sacro-saint au profane, du plus près au plus loin, en fonction de la sainteté statutaire de chacun, sur le modèle du temple où des seuils munis de marches manifestent architecturalement la gradation du moins saint au plus saint. Un premier cercle de prêtres, disposés selon leur rang aristocratique autour de l’autel et de la cella, desservent la table du souverain et veillent à l’entretien de ses salles. Un deuxième cercle comprend les lévites qui ne sont pas habilités au service de l’autel, mais sont chargés des rites de sang et dont le livre biblique du Deutéronome fait des intermédiaires entre les prêtres et le peuple. Au-delà, les «fils d’Israël» entourent le sanctuaire. Autour, le monde profane, peuplé d’«étrangers», est regardé comme hostile et impropre à la vie. Il est à conquérir, à gagner à la sacralité, pour étendre la terre sainte à toute la terre. Dans le monde tel qu’il est, la présence profane des «étrangers» au sein de l’assemblée provoquerait l’impureté et remettrait en cause la sacralité du culte et du lieu, et menacerait l’économie du monde et la vie sur la terre. Des livres comme celui de Ruth montrent toutefois que les frontières entre cercles de statut divers sont poreuses et n’ont jamais été infranchissables. Sur le plan spatial, l’organisation concentrique du culte rappelle la description par Hérodote de l’ordonnancement du cortège du roi perse Xerxès. En particulier, un espace devait séparer les contingents perses, entourant le Grand Roi et marchant en tête, des autres nations de l’empire suivant, pêle-mêle, sans avoir été triés, de manière à empêcher le mélange de ces derniers avec les gens de la maison du roi. De même à la fin du cortège, la cavalerie perse est séparée du reste des troupes par un intervalle de deux stades (environ 400 m). Tel est le modèle qui régit les descriptions par les textes de l’assemblée cultuelle de Jérusalem.
Les lois civiles se lisent au livre du Deutéronome qui s’adresse à l’ensemble du peuple, prêtres, lévites et fils d’Israël. Ces lois civiles sont rédigées dans la même forme que les lois cultuelles signifiant que lois rituelles et civiles ont une commune origine liée à l’autel où se joue la relation verticale qui lie l’ensemble du peuple à son dieu souverain. Les «codes» sacerdotal et deutéronomique, qui constituent les éléments dynamiques du Pentateuque, s’articulent au sein du livre du Lévitique qui occupe le centre des cinq livres. Au sein de l’ensemble littéraire, le livre du Lévitique ouvre l’espace symbolique où se noue l’enjeu de la transmission de la «sacralité» sacerdotale, issue du sacrifice, à la «sainteté» que confère aux fils d’Israël la mise en pratique de la Loi, afin de sanctifier toute la terre, comme l’avait fait Dieu au 7e jour de la création.