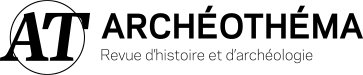Les animaux s’auto-médicamentent avec des plantes, et c’est un comportement que les hommes observent et imitent depuis des millénaires.
Le terme zoopharmacognosie – « connaissance de la médecine animale » – a été inventé en 19871. Mais comme l’a souligné le naturaliste romain Pline l’Ancien il y a 2 000 ans, de nombreux animaux ont fait des découvertes médicales utiles à l’homme. En effet, un grand nombre de plantes médicinales utilisées dans les médicaments modernes ont été découvertes pour la première fois par les peuples indigènes et les cultures antiques qui ont observé les animaux employant des plantes et les ont imités.
Ce que l’on peut apprendre en observant les animaux
Certains des premiers exemples écrits d’automédication animale figurent dans l’« Histoire des animaux » d’Aristote, datant du IVe siècle avant notre ère, comme l’habitude bien connue des chiens ou des chats de manger de l’herbe lorsqu’ils sont malades, probablement pour se purger et se donner des vermifuges. Aristote a également noté qu’après l’hibernation, les ours recherchent l’ail sauvage comme premier aliment. L’ail sauvage est riche en vitamine C, en fer et en magnésium, des nutriments bénéfiques pour la santé après une longue sieste hivernale. Le nom latin reflète cette croyance populaire : Allium ursinum se traduit par « ail des ours », et le nom commun dans de nombreuses autres langues fait référence aux ours.
Pline l’Ancien explique que l’utilisation du dictame, également connu sous le nom d’origan sauvage, pour soigner les blessures de flèches est née de l’observation de cerfs blessés qui broutaient l’herbe. Aristote et Dioscoride attribuent cette découverte aux chèvres sauvages. Virgile, Cicéron, Plutarque, Solinus, Celsus et Galien ont affirmé que le dictame avait la capacité d’expulser la pointe d’une flèche et de refermer la blessure. Parmi les nombreuses propriétés phytochimiques connues du dictame figurent des effets antiseptiques, anti-inflammatoires et coagulants.

Selon Pline toujours, les cerfs connaissaient aussi un antidote contre les plantes toxiques : les artichauts sauvages. Les feuilles soulagent les nausées et les crampes d’estomac et protègent le foie. Pour se guérir des morsures d’araignées, écrit Pline, les cerfs mangeaient des crabes échoués sur la plage, et les chèvres malades faisaient de même. Les carapaces de crabe contiennent notamment du chitosan, qui renforce le système immunitaire.
Lorsque les éléphants avalent accidentellement des caméléons cachés sur des feuilles vertes, ils mangent des feuilles d’olivier, un antibiotique naturel pour combattre les salmonelles hébergées par les lézards. Selon Pline, les corbeaux mangent des caméléons, mais ingèrent ensuite des feuilles de laurier pour contrer la toxicité des lézards. Les feuilles de laurier antibactériennes soulagent la diarrhée et les troubles gastro-intestinaux. Pline note aussi que les merles, les perdrix, les geais et les pigeons consomment également des feuilles de laurier en cas de problèmes digestifs.
On dit que les belettes se roulent dans la rue (Ruta graveolens), une plante à feuilles persistantes, pour soigner les blessures et les morsures de serpent. La rue fraîche est toxique. Sa valeur médicale n’est pas claire, mais la plante séchée entre dans la composition de nombreux médicaments traditionnels. Les hirondelles ramassent une autre plante toxique, la célandine, pour en faire un cataplasme pour les yeux de leurs oisillons. Les serpents qui sortent d’hibernation se frottent les yeux sur du fenouil. Les bulbes de fenouil contiennent des composés qui favorisent la réparation des tissus et l’immunité.
Selon le naturaliste Claudius Aelianus (Claude Élien, v. 175-235), qui vivait à la fin du IIe s. et au début du IIIe siècle de notre ère, les Égyptiens tiraient une grande partie de leurs connaissances médicales de la sagesse des animaux. Élien a décrit des éléphants soignant des blessures de lance avec des fleurs d’olivier et de l’huile. Il a également mentionné des cigognes, des perdrix et des tourterelles qui écrasaient des feuilles d’origan et appliquaient la pâte sur les blessures.
L’étude des remèdes d’origine animale s’est poursuivie au Moyen Âge. Un exemple tiré du Bestiaire d’Aberdeen, un recueil anglais du XIIe siècle sur les animaux, raconte que les ours enduisent les plaies avec de la molène. La médecine populaire prescrit cette plante à fleurs pour calmer la douleur et guérir les brûlures et les blessures, grâce à ses substances chimiques anti-inflammatoires.
Le manuscrit d’Ibn al-Durayhim « De l’utilité des animaux », datant du XIVe siècle, rapporte que les hirondelles soignent les yeux des oisillons avec du curcuma, un autre anti-inflammatoire. Il a également noté que les chèvres sauvages mâchaient et appliquaient de la sphaigne (genre de mousses de la famille des Sphagnaceae) sur les blessures, tout comme les orangs-outans de Sumatra le font avec de la liane. Les pansements à base de sphaigne neutralisent les bactéries et combattent les infections.

La pharmacopée naturelle
Bien entendu, ces observations prémodernes relevaient du savoir populaire et non de la science formelle. Mais les récits révèlent l’observation et l’imitation à long terme de diverses espèces animales se soignant elles-mêmes avec des plantes bioactives. Tout comme l’ethnobotanique indigène traditionnelle permet aujourd’hui de trouver des médicaments qui sauvent des vies, l’analyse scientifique des observations anciennes et médiévales pourrait conduire à la découverte de nouvelles plantes thérapeutiques.
L’automédication animale est devenue une discipline scientifique en plein essor. Les spécialistes rapportent des observations d’animaux, des oiseaux aux rats, en passant par les porcs-épics et les chimpanzés, qui utilisent délibérément un répertoire impressionnant de substances médicinales. Une observation surprenante est que les pinsons et les moineaux collectionnent les mégots de cigarettes. La nicotine tue les acariens dans les nids d’oiseaux. Certains vétérinaires permettent même aux chiens, chevaux et autres animaux domestiques malades de choisir leurs propres prescriptions en reniflant divers composés botaniques.
Mais des mystères subsistent. Personne ne sait comment les animaux détectent les plantes qui soignent les maladies, guérissent les blessures, repoussent les parasites ou favorisent la santé d’une manière ou d’une autre. Répondent-ils intentionnellement à des crises sanitaires particulières ? Et comment leurs connaissances sont-elles transmises ? Ce que nous savons, c’est que nous, les humains, apprenons depuis des millénaires les secrets de la guérison en observant les animaux s’auto-médicamenter.
D’après Adrienne Mayor, Research Scholar, Classics and History and Philosophy of Science, Stanford University, dans The Conversation, mai 2024.
Note
- Certains avancent la date de 1993 quand est paru l’ouvrage Rodriguez, E. et Wrangham, R., « Zoopharmacognosy: The use of medicinal plants by animals », Phytochemical Potential of Tropical Plants, vol. 27, 1993, p. 89–105.